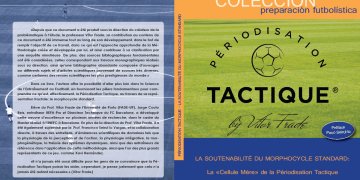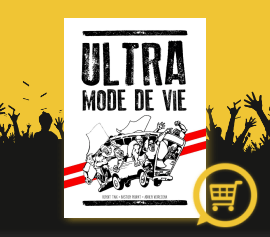Entre exils, déportations, travail forcé, succès et fins tragiques, les histoires des familles de Mikhail An et Viktor Tsoi racontent une partie du destin des Koryo-sarams. Une histoire qui s’étale sur le XXe siècle de la Russie orientale aux steppes d’Ouzbékistan et du Kazakhstan sans oublier Saint-Pétersbourg.
Koryo-saram ? Un nom qui peut paraitre bien barbare. Il se traduit littéralement en « personnes de Corée » et définit principalement ces Coréens qui ont émigré en Russie puis en URSS au début du XXe siècle. Cet exil débuta au coeur du XIXe siècle mais s’intensifia au début du siècle suivant. Pourquoi ? Cette population cherchait alors en Russie orientale des terrains où ils pouvaient se consacrer à l’agriculture puis surtout fuir l’annexation de la Corée par le Japon en 1910.
Ils sont ainsi environ 170 000 Koryo-sarams installés aux confins de l’URSS dans les années 1930, dans la région proche de Vladivostok. Cependant, leur destin bascule en 1937 quand Joseph Staline signe un décret pour acter leur déportation vers les steppes du Kazakhstan et d’Ouzbékistan. Alors que les tensions s’accentuent entre l’URSS et le Japon, le Père des Peuples craint que les Koryo-Sarams puissent agir comme des espions pour les Nippons. Ce peuple, un des premiers à subir les déportations forcées, doit donc se réinventer dans des conditions extrêmes.
Beaucoup de membres de la communauté succombent à ce voyage de plus de 7000 kilomètres vers l’Asie Centrale mais les familles de Mikhail An et de Viktor Tsoi posent les pieds dans cette région inconnue. Pour les premiers, ce sera l’Ouzbékistan. Pour les seconds, le Kazakhstan.
La force de travail des Koryo-Sarams et leurs talents agricoles leur permettent bientôt de dompter ces terres compliquées. Ils installent des systèmes d’irrigation qui facilitent la culture du riz et des légumes. C’est dans ce contexte où les Koryo-Sarams deviennent un peuple apprécié par les autochtones que Mikhail ‘Misha’ An nait en 1952.
Pour le jeune Misha, le travail de la terre est rapidement délaissé au profit du football. Dmitry, son frère ainé de 13 ans, est en effet un joueur professionnel. Mikhail marche donc dans ses pas et à Tashkent, il devient le talent à suivre. Le grand club local, le Pakhtator, ne laisse pas passer un tel joueur et le polit.
A 18 ans, ce milieu à la technique superbe et à l’accélération dévastatrice s’installe dans l’équipe première de Pakhtator. Il forme alors un duo choyé avec un autre fils d’immigrés, le délicieux Vassilis Hatzipanagis. Cet ailier est l’enfant d’immigrés grecs qui font partie de la large diaspora grecque venue s’établir à Tashkent après la guerre civile des années 1940.
Les deux jeunes hommes brillent et permettent à Tashkent de s’installer dans l’élite du football soviétique. Mikhail An est même sélectionné avec les diverses équipes nationales de jeunes en URSS puis plus tard avec les seniors. En 1976, il est ainsi le capitaine de la sélection soviétique qui remporte le championnat d’Europe U23.
A 26 ans, il est au sommet de son art : capitaine respecté, homme de valeurs et symbole local. Mais tout s’arrête le 11 septembre 1979. Alors qu’il est blessé et malgré sa phobie des avions, An accompagne ses coéquipiers pour un déplacement en Biélorussie. Malheureusement, ils n’atterriront jamais, percutant un autre avion au-dessus de l’Ukraine. Ce jour-là, An est l’un des dix-sept membres du Pakhtator Tashkent à perdre la vie.
En 1979, Viktor Tsoi n’est encore qu’un jeune homme de 17 ans. Sa famille a depuis longtemps quitté l’Asie centrale pour s’installer à Saint-Pétersbourg afin de suivre son père, ingénieur de métier.
S’il s’adonne aux arts martiaux, ce Koryo-saram trouve sa voie loin des terrains de sport. Au coeur des années 1970, le rock est un mouvement underground en URSS qui s’exprime surtout à Saint-Pétersbourg et Moscou. Petit à petit, Tsoi intègre cette scène qui n’est pas vraiment du goût des autorités locales.
Viktor brille d’abord grâce à sa guitare puis se met à écrire des chansons, stimulé par ses rencontres avec quelques artistes émergents. Il multiplie les concerts underground à Saint-Pétersbourg et à Moscou puis crée son propre groupe : Kino.
Les années 1980 sont l’histoire d’une ascension vertigineuse pour Tsoi et son groupe Kino, comme le raconte le film Leto. D’artiste confidentiel, Viktor Tsoi devient un symbole de cette jeunesse soviétique qui veut s’émanciper des traditions, de la culture et des mentalités de ses aînés.
Tsoi incarne l’esprit de la Perestroika, du changement. Ou la Perestroika incarne l’essence de Tsoi. C’est selon. En tout cas, Tsoi et Kino deviennent la bande-son d’une génération avec des chansons qui restent aujourd’hui encore célèbres et vénérées en ex-URSS et au-delà.
Mais comme pour An et de nombreux Koryo-sarams dans l’histoire, le destin de Tsoi se conclut de manière dramatique. Le 15 août 1990, à 28 ans, il perd le contrôle de sa voiture sur une route lettonne, sans doute trahi par la fatigue.
26 ans, 28 ans. Les destins tragiques d’An et Tsoi confirment que les héros meurent jeunes. Mais leurs histoires démontrent aussi que cette communauté méconnue a su faire preuve de résilience et se réinventer pour enfanter deux symboles du football et du rock soviétiques. Deux étoiles vagabondes, deux Koryo-sarams.
Et puisqu’il faut sans doute finir par un morceau de Viktor Tsoi : quoi de mieux que Derevo (‘l’arbre’) ?
Je sais que mon arbtre ne vivra pas plus d’une semaine
Je sais que mon arbre, dans cette ville, est sans espoir mais je passe tout mon temps avec lui
Je m’ennuie avec toutes mes autres choses
On dirait que cet arbre est ma maison
On dirait que cet arbre est mon ami
J’ai planté cet arbre, j’ai planté cet arbre
Je sais que demain cet arbre sera peut-être brisé par un écolier
Je sais que cet arbre pourrait bientôt me quitter
Mais tant qu’il est là, je suis toujours à ses côtés
Avec lui, je suis joyeux. Avec lui, je suis plein de douleurs
On dirait que c’est mon monde
On dirait que c’est mon fils
J’ai planté cet arbre, j’ai planté cet arbre