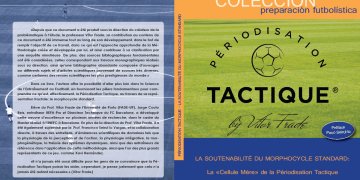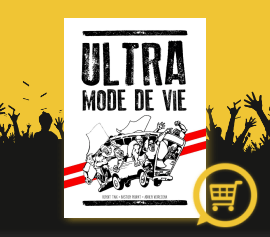La plus grande compétition de ballon est aussi le plus grand théâtre humain. Au dernier rassemblement, dans un décor exotique, il s’était laissé gagner par la fièvre du jeu. Cet été, c’est dans la réduction des espaces et l’organisation que la Coupe du monde 2018 a offert un spectacle fascinant de petites histoires et d’enseignements tactiques.
La plus grande compétition de ballon est aussi le plus grand théâtre humain. Au dernier rassemblement, dans un décor exotique, il s’était laissé gagner par la fièvre du jeu. Cet été, c’est dans la réduction des espaces et l’organisation que la Coupe du monde 2018 a offert un spectacle fascinant de petites histoires et d’enseignements tactiques.
Sous nos yeux pendant plus d’un mois, elle nous a présenté des scènes tragiques, d’autres mémorables, des moments de joies, d’autres de désespoirs. Et surtout, de belles histoires. Il y a eu les larmes – de joie – de Lozano après son premier but en sélection contre l’Allemagne. Le triplé de Ronaldo contre l’Espagne dès le second jour. Les équipes sud-américaines à domicile lors de chaque rencontre. Les larmes – d’impuissance – de Giménez à quelques minutes de la fin d’Uruguay-France. La seconde période de Colombie-Angleterre comme un remake de la bataille de Nuremberg (2006) opposant les Portugais aux Néerlandais. Les coups de têtes de Yerri Mina contre le Sénégal, la Pologne et l’Angleterre. Les courses téméraires de Kylian Mbappé. Les matchs surprenants du Péruvien Carrillo et son association explosive avec Advincula. Le coup de pied de Marcos Rojo qui envoie des milliers d’Argentins peinés défier la France en huitième de finales. L’amour des pieds gauche de Quintero et de Carlos Vela. Le match tragique de Kroos contre la Suède avant sa frappe victorieuse dans les arrêts de jeu, suivi de l’élimination de l’Allemagne contre la Corée du Sud. Les quelques tentatives de trivela de Quaresma avant de la placer en lucarne contre l’Iran pour le troisième match de son premier Mondial. La compétition de Luka Modrić et Paul Pogba, deux planeurs au-dessus des terres peu fertiles de l’entrejeu en Russie. Et à la fin, il reste une tonne d’émotions et de souvenirs.
L’exposition
Mais que retient-on lorsque le spectacle est fini ? Le salut des acteurs sur la scène, trophée en main ? Pas vraiment. Si la Coupe du Monde ne peut se résumer par un unique nom dans les livres d’histoire, elle est par-dessus tout une courte aventure mêlant au quotidien le supporter dans une succession de rêveries, d’interrogations et de débats. Pendant plus d’un mois, des millions d’amoureux répartis dans les trente-deux pays sont plongés dans un suspense qui suit sans interruption l’enchaînement des rencontres. Le lendemain du triplé de Ronaldo contre l’Espagne, comment va réagir Lionel Messi face à l’Islande ? Et de quelle manière l’organisation islandaise, surprenante à l’Euro 2016 va bloquer le n°10 argentin ? Ainsi tout le long de la pièce. Ivre d’espérance.
Du 14 au 19 juin, les acteurs se sont montrés et ont donné la tonalité de la représentation. Et comme au théâtre, le principal des actions reposait sur la structure des interprètes. Les inspirations, elles, passaient après : une fois que le ballon était rapidement arrivé dans les trente derniers mètres. Rare, face à la multitude des blocs-bas. « Pour moi, le football est un orchestre. Plus les joueurs sont inspirés par la même musique, plus ils peuvent jouer une bonne chanson », disait Arsène Wenger dans Stillness and Speed (2013), la biographie de Dennis Bergkamp. Lors de cette nouvelle édition mondiale, malgré un degré divers de « technicité » (Omar Da Fonseca), sous l’influence de la prudence du bloc-équipe, les notes dévoilées par les artistes de beaucoup de nations dégageaient une même symphonie. Peu de collectifs ont pris l’initiative avec la balle et leurs priorités ont été de densifier l’axe du terrain pour empêcher l’adversaire d’y construire le jeu. En bloc médian et dans l’attente de contre-attaque depuis une balle récupérée au milieu, les Russes accouchent de 5 buts face à une Arabie Saoudite joueuse mais qui se découvre aisément, pour l’ouverture du tournoi.
Conservatisme et illusion
En Russie, la recherche de l’équilibre collectif a été la priorité de la plupart des nations. Elles s’y sont présentées avec des idées claires : organisation et solidité en défense, organisation et invention en attaque. Dans cette idée, l’alignement en 4-4-2, rendant les joueurs très proches les uns des autres et permettant une transition rapide entre les phases sans ballon et avec ballon, a fait figure de fondement. Sur les quatre-vingt-douze compositions de départ du premier tour (48 matchs), cinquante-cinq étaient organisées dans ce dispositif en phase défensive. Au point de dogme chez certains entraîneurs, le jeu de position est avant tout une manière d’attaquer. Et cette stratégie nécessite du temps et du contrôle. Or dans un football de sélection où les fenêtres internationales sont modestes, la tendance a été de présenter un football de réaction, d’un côté.
De l’autre, étendards du jeu de possession en sélection depuis plusieurs années, l’Espagne et l’Allemagne ont poursuivi dans la même politique de jeu et ses quelques principes forts : contrôle du jeu, pressing à la perte, redoublements de passes. Mais pour elles, ce contrôle de la balle ne s’est pas toujours substitué en une maîtrise de la rencontre, comme pour les Three Lions. Depuis l’arrivée de Southgate et de son adjoint Steve Holland, l’Angleterre s’est lancée dans un football de possession. Et après deux ans de travaux, de changements d’hommes et d’animations, pour cette Coupe du monde elle a montré un profil ressemblant à l’Italie 2016 de Conte. En 3-3-2-2, elle a consacré la transmission de ses défenseurs centraux (particulièrement Stones) jusqu’aux milieux mais une difficulté à créer dans les quarante derniers mètres. Lingard et Alli (comme Parolo et Giaccherini) attaquent la profondeur et courent davantage dans l’espace plutôt qu’ils le créent balle au pied. Derrière eux, Henderson ne s’affiche pas comme un n°6 de jeu de position. À partir de là, l’Angleterre est en difficulté dans la construction et se trouve forcée de s’appuyer sur ses latéraux. En 2010 et 2014, années des sacres mondiaux, les deux premières sélections ont surtout profité chacune à leurs tours, des fausses manœuvres adverses en défense et des phases de jeu direct. En 2018, elles sont tombées contre des nations qui savent se replier, densifier l’axe et la surface, établir des pressings à plusieurs sur les joueurs phares et donc comment défendre. En 3 compétitions mondiales, l’art de la défense s’est promulgué. En opposition à cela, pour les équipes de possession l’art d’attaquer s’est rétracté. En contre-pied à la réduction des espaces, elles n’ont pas su miser dans les espaces réduits, ni étaient capables par idéologie de créer de plus grands espaces. L’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine ont montré le visage d’une équipe qui contrôlait plus la balle qu’elle ne jouait. Et c’est sur phase défensive qu’elles se sont écroulées. Pour ces équipes protagonistes, la compétition restera pour toujours étampée par la crise de l’animation offensive et la détresse de la transition sans ballon.
Finalement, seul le Mexique a montré de l’aisance face à toutes ces équations : contre l’Allemagne, les hommes de Juan Carlos Osorio ont brillé avec seulement 33% de possession en profitant de la transition défensive perméable de ceux de Joachim Low. Et face à la Corée du Sud, c’est sur attaque placée qu’ils surprennent : supériorité à la relance, des défenseurs centraux qui portent haut la balle et n’hésitent pas à relancer pour créer des relations avec leurs attaquants, présence entre les lignes, largeur du bloc grâce aux latéraux et transition défensive structurée.
Arrivé à destination. Alors que la nette domination espagnole sur le monde (2008, 2010, 2012) dévoilait à tous la volonté de la belle de récompenser les hommes qui se montraient entreprenants pour elle, les performances attentistes mais pourtant remarquées de l’Uruguay (2011) et de l’Italie (2014) en sélections, du Real Madrid, de l’Atlético et de Chelsea en clubs, montraient un changement de cap implicite. « Dans la majorité des sélections, le désir de gagner (ou de ne pas perdre) a accentué l’importance des surfaces au détriment de l’entrejeu (soit au détriment d’un jeu plus construit) », écrivait Jorge Valdano dans son livre Fútbol: el juego infinito publié en 2016. La durée d’un tournoi, adopter une organisation défensive performante et peu docile, associée à des principes offensifs simples peut transporter plus loin que l’espoir, comme les Pays-Bas et l’Italie en 2014, ou le Pays de Galles et le Portugal en 2016. Comme eux, la France en 2018 s’est basée sur la qualité de ses deux extrémités du terrain : une solide charnière Varane-Umtiti permettant de jouer bas, combinée à des courses offensives, qu’un Paul Pogba au milieu rend dans l’instant assassines. De leurs côtés, les nations à forte identité de jeu n’ont pas pris de points, ou très peu : le Maroc n’a pas marqué un seul but ni récolté un seul point. Le Pérou de Ricardo Gareca s’en sort qu’avec une victoire contre l’Australie (2-0). La conquête française, l’élimination de l’Allemagne en poules et de l’Espagne dès les huitièmes de finales acquiescent l’une des maximes de Mourinho : « On peut être en contrôle quand on n’a pas le ballon et en difficulté quand on a le ballon ».
La crise de jeu
Cet été, face à ces blocs médians qui comblent l’axe, abandonnent -volontairement – le ballon plutôt que de risquer un déséquilibre fatal et atrophient l’élaboration, un manque d’équilibre et une crise de jeu se sont fait marquants. De l’abondance (Serbie, Russie, Suisse, Pologne…) de double-pivot devant la défense faisant naître des phases de possession gelées avec un bloc coupé en deux parties et aucun joueur derrière la première ligne de pression. Et de l’absorption du n°10. Pour les créateurs, deux solutions (plus subies que choisies) se sont posées. Une première, c’est De Arrascaeta évincé après 59 minutes pour l’ensemble de la compétition, lors du match d’ouverture et remplacé par Lucas Torreira au nom de la compacité du bloc-équipe de la Celeste d’Óscar Tabárez. Et une seconde, avec les Eriksen, Milinković-Savić, Özil, Messi, Griezmann et Kagawa contraints d’être servis dans leurs camps plutôt qu’au cœur du bloc adverse. Comme une espèce animale, lorsqu’on investit son territoire, le numéro 10 devient si rare que l’on se met à douter de son existence. Et face au cyclone de l’entrejeu, les joueurs reculés ne trouvent que le moyen de le contourner, en étant conscient que n’importe quel rapprochement dans l’axe peut les engouffrer en quelques secondes. Surtout à 32 km/h. Au Mondial, cela a symbolisé un vide de construction, un manque d’élaboration et peu de liens entre les lignes : le ballon circule par l’axe mais les supériorités se font vers les ailes. Et enfin : l’usage du jeu long. S’il a épaté par son efficacité face au but (six au-dessus de la barre des 3 buts), le grand numéro 9 a surtout donné un sens à l’idée du long ballon. Avec la présence de Lukaku, Mitrović et Dzyuba, la Belgique, la Serbie et la Russie ont trouvé un phare offensif quand elles cherchaient une orientation. Sans Cavani, les hommes de Tabárez n’ont pas trouvé de direction à la récupération du ballon en demi-finale face à la France. Avec Giroud et Mandžukić, les deux sélections finalistes ont pris le chemin des sommets.
Au Brésil, le pays des jolies courbes, la géométrie du football répandait bien des défenses à trois axiaux (Chili, Pays-Bas, Mexique, Costa Rica…) et offrait parallèlement un spectacle de combinaisons profitant de l’amplitude offensive, de la supériorité numérique à la relance et de la présence d’un n°10 entre les lignes. En Russie, l’Angleterre, la Belgique, le Costa Rica et le Nigeria ont évolué dans un système à trois centraux et ont fait preuve d’élaborations séduisantes. Mais c’est un concert de combinaisons sur coups de pied arrêtés et de paraboles aériennes qui ont fait lever les foules. En quart de finale, la France, la Belgique et l’Angleterre ont ouvert le score ainsi. En demi-finale, la première élimine la seconde de cette manière. En finale, les Bleus ouvrent le score sur un coup-franc excentré tiré par Griezmann. Et ce n’est pas ça qui a empêché d’offrir un joyeux spectacle.
Baisser de rideau
Au plus vaste État du monde, l’affrontement s’est axé sur l’espace : les grands n’en n’ont pas trouvé pour déployer leurs armes, les autres ont tout fait pour en créer au maximum dans le dos de l’adversaire ou dominer l’espace aérien. Le huitième de finale Espagne-Russie par son opposition de styles de jeu, restera le point culminant de ce Mondial : une équipe regroupée près de son but, une autre qui s’est totalement emparé du ballon (1029 passes) mais qui ne jure que par les ailes pour attaquer. De plus, la rencontre se clôtura sur un match nul (1-1) avec un nouveau but sur penalty (le vingt-sixième des 29 sifflés, record) et un but contre son camp (le dixième des 12 concédés, record) sur coup de pied arrêté, forçant les deux équipes à s’éliminer aux tirs au but (la première des quatre de la phase finale, record de 1998 égalé). En finale aussi, la France et la Croatie ont exhibé un affrontement de dialectes : les Croates dans le jeu puis dans la tête, les Français dans la tête puis dans le jeu. Et après plus de trois semaines d’attente, les spectateurs font enfin face au dénouement. Le jeu a-t-il changé ? Sur les quatre derniers participants de la compétition, trois étaient à l’aise avec le football de possession. Pourtant la victoire des Bleus ne porte aucun germe de révolution mais avant tout une leçon de pragmatisme glaciale et d’un réalisme insensible. Avec ça, les équipes de réaction ont peut-être trouvé un modèle, quand les admirateurs de micro-tactique pourront se pencher sur les travaux de Roberto Martinez au cours du tournoi. Encore une fois en Coupe du Monde, les héros n’ont pas suffi et cela pose un constat implacable : ils ne suffiront jamais face aux mystères de la Coupe. Et jusqu’au bout, elle aura été énigmatique. Si aucune sélection n’a marqué l’époque et si le meilleur buteur n’a pas été effrayant dans le jeu, les affrontements auront au-moins marqués les foules. On a vu la Russie tenir tête à l’Espagne pendant plus de 120 minutes mais aussi la Corée du Sud balancer la Mannschaft dans les cordes. Plongés dans une attente déjà démesurée par l’événement, les difficultés posées par les blocs-bas ont investi les spectateurs dans un flot de surprises imprévues. Mais surtout, elle ne nous a pas privé de son secret : un excès de tension, d’euphorie et de souffrance, entre histoires et souvenirs. Et beaucoup de passion si l’on en croit la plume de Jorge Valdano : « Le football c’est l’émotion de l’incertitude et la possibilité de la jouissance. »