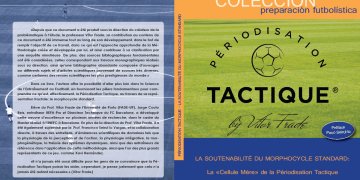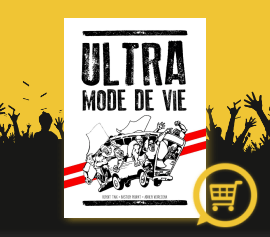Après avoir vécu une saison compliquée en deuxième division, l’Independiente a fini par décrocher son billet dans l’élite du football argentin après sa victoire 2 buts à 0 face à Huracan mercredi. Avant la dernière journée, le septuple vainqueur de la Libertadores comptait le même nombre de points qu’ « El Globo » à la 3ème place. L’année dernière, trois semaines avant la descente officielle de l’Independiente, Luciano Olivera un supporter du « Rojo » avait ému toute l’Argentine grâce à une lettre intitulée « aspirines et bonbons » qu’il a dédiée à son père défunt. Une manière de nous rappeler que le football n’est pas simplement une question d’argent et de chiffres mais aussi de sentiments et d’anecdotes. Cette lettre s’intitule « aspirines et bonbons ».
Après avoir vécu une saison compliquée en deuxième division, l’Independiente a fini par décrocher son billet dans l’élite du football argentin après sa victoire 2 buts à 0 face à Huracan mercredi. Avant la dernière journée, le septuple vainqueur de la Libertadores comptait le même nombre de points qu’ « El Globo » à la 3ème place. L’année dernière, trois semaines avant la descente officielle de l’Independiente, Luciano Olivera un supporter du « Rojo » avait ému toute l’Argentine grâce à une lettre intitulée « aspirines et bonbons » qu’il a dédiée à son père défunt. Une manière de nous rappeler que le football n’est pas simplement une question d’argent et de chiffres mais aussi de sentiments et d’anecdotes. Cette lettre s’intitule « aspirines et bonbons ».
Aspirines et bonbons
« La première fois que j’ai eu la sensation de voir mon père mourir, que je l’ai vu effondré pour de vrai, ce fut en allant voir jouer Independiente.
Rodolfo (c’était son nom) était journaliste. Il travaillait pour la télé, la radio et la presse papier. Tous les vendredis, il avait l’habitude de rentrer avec un cadeau : une accréditation de journaliste pour aller au stade. J’ai grandi en côtoyant les endroits privilégiés. J’ai vu de nombreux matchs en cabine de commentateurs et en tribune présidentielle. Cela faisait partie du “chic” de mon père.
Mais en 1980, les choses avaient changé. Mon père était sans travail. Dans l’Argentine de la dictature et de la corruption, il avait ouvert un bureau de tabac dans une galerie piétonne. Ce petit “business”, vestige d’un héritage familial, ne nous donnait aucun luxe. On vivait sans manquer de rien mais en se serrant la ceinture. En plus de ça, la profession de journaliste avait perdu de son prestige. Cet auteur reconnu devait désormais vendre des alfajores (biscuits argentins), bonbons et cigarettes. Un détail : il travaillait tout le temps en costume-cravate. J’ai du mal à me souvenir de lui portant d’autres habits, c’était quasiment son uniforme.

Il est vrai que ce jour là, du haut de mes 11 ans de “sale gamin”, j’avais insisté pour aller au stade en cette chaude journée de décembre. On jouait le match retour d’une demi-finale du tournoi national. Le Racing de Cordoba avait gagné 4 à 0 le match aller et je ne sais pas quel pressentiment nous poussait a croire en la qualification. Nous avons pris le bus pour Avellaneda (on avait vendu la vieille Fiat 800 pour payer une facture) et avons engagé la longue marche sur l’avenue Alsina. Nous étions des milliers à marcher en direction du stade de la Doble Visera (ancien stade d’Independiente) au milieu des drapeaux, des maillots, des casquettes et des chants de “on va être champion”.
En arrivant à la billetterie, j’ai vu que mon père prenait la direction de la file pour le virage. Il a dû voir le visage de déception du gamin mal habitué par les cabines de presse et autres tribunes présidentielles. Il m’a dit un truc du genre “Aujourd’hui on va ici, c’est mieux”. Je ne l’ai pas cru. J’ai surtout compris que l’on n’avait pas le choix. La file à côté, pour les places assises, était beaucoup plus ordonnée, celle pour les virages était un ensemble de cris, de mouvements de foule… Mon père –qui était beaucoup plus à l’aise avec les lettres plutôt qu’avec la foule– poussait pour arriver aux fenêtres de la billetterie mais il n’avançait pas. D’un coup, je l’ai vu sortir de cette marée humaine, de ces acheteurs de dernière minute et il m’a dit : “Viens, c’est pas pour nous tout ça”. Sans réfléchir, un “Et si on allait en tribune latérale ?” est sorti tout seul de ma bouche. Je crois que ma question fut un coup de poignard. Il me répondit : “On n’a pas d’argent”. Je me rappelle du caractère sec de sa réponse. J’ai compris aujourd’hui que c’était le dernier bouclier d’une personne diminuée, qui ne pouvait pas accomplir “quelque chose” pour son fils. C’était grave ? Bien sûr que non. Mais pour lui, tout cela était un symbole. Il n’était plus ce qu’il avait été par le passé. Les portes des cabines ne s’ouvraient plus. Il ne pouvait plus payer deux entrées en tribunes latérales. Avec un air abattu, nous sommes rentrés par l’avenue Alsina, une rue qui m’a toujours paru horrible.
Pendant que l’on s’éloignait du stade, je me rappelle avoir entendu le rugissement des tribunes après la sortie des joueurs… À quelques rues du stade, mon père arrêta soudainement sa marche. Il me regarda et me dit : “Attend une seconde”. Il s’assit sur le trottoir d’une maison. “Qu’est qu’il t’arrive”, je lui dis. “Je ne me sens pas très bien, ça va me passer”. Une femme qui avait vu la scène de chez elle, sortit et lui donna un verre d’eau. La scène ne dura pas longtemps, il se remit rapidement. Quelques instants plus tard, nous étions de nouveau dans le bus et une demi-heure plus tard, à la maison. Ce qui semblait être un simple malaise, pour moi, fut un signe grave. Je ne sais pas bien pourquoi mais en ce jour de décembre, quelque chose me dit que mon père était en train de mourir. Il avait seulement 53 ans mais il fumait beaucoup, il avait déjà eu un infarctus quelques années auparavant et il ne faisait pas attention à lui… Mais il était (je l’ai compris des années après) surtout très déprimé. Rodolfo est parti un an et demi plus tard sans avoir vraiment lutté et sans comprendre qu’il était plus important de prendre soin de lui que de s’adonner aux vices auxquels il avait succombé dès l’âge de 14 ans. Et il était surtout très fier. Il nous a vite quitté. Ma colère contre lui, pour ne pas avoir été là, pour ne pas avoir fait face, pour ne pas avoir lutté, dura des années.
Cet homme, malgré quelques comportements bêtes avant de mourir, était mon idole. Ce porteño (habitant de Buenos Aires) fan de tango qui ne m’a pas laissé un sou, m’a légué une poignée de choses inestimables : le goût pour l’Histoire, la passion de la lecture, le plaisir d’une bonne partie d’échec, l’athéisme, l’image d’une décence inébranlable qui fut importante pour que je ne succombe pas aux tentations et bien sûr le “paladar negro” du supporter d’Independiente (NDLR : expression qui désigne le goût pour le beau jeu en Argentine, il est généralement associé aux supporters de River Plate et d’Independiente). Depuis tout petit, j’ai appris ces deux vers : Maril, De La Mata, Erico, Sastre et Zorrila puis Miceli, Ceconatto, Lacacia, Grillo et Cruz (deux équipes mythiques d’Independiente). Il faut les prononcer rapidement, cela montre que tu es une personne qui sait. Je me rappelle que nous nous enroulions de drapeaux dans la maison pendant que l’on attendait que la “Central Terrena de Balcarce” retransmette le match à la radio d’une finale de Libertadores jouée à Montevideo, Sao Paulo ou Santiago… Je nous vois encore sauter et crier sur les buts de Bertoni, répéter Bo Bo Chini (NDLR : pour Bochini, légende du Rojo) jusqu’à devenir aphone, applaudir les tacles de Pancho Sa, les courses de Balbuena, les coups francs de Pavoni… J’aimais écouter cette anecdote d’un après-midi où Bernado s’était rapproché de la tribune basse latérale et avait dédié un but à ma mère. J’aimais Boneco, ce chien plein de puces qui rentrait sur le terrain avec les joueurs en portant l’écusson d’Independiente dans sa bouche.
Quand j’étais petit, Rodolfo avait l’habitude de venir avec un bonbon. Il me le donnait et me disait “C’est M.Independiente qui te l’envoie”. Des fois, au lieu d’un bonbon, il me ramenait une aspirine. Devant mon visage de dégoût, il répondait “C’est M.Racing qui te l’envoie” (NDLR : Racing étant le plus grand rival d’Independiente). C’était une personne sérieuse mais de temps en temps, il nous faisait des blagues mémorables. Le vieux est parti en juin –quelle coïncidence– de 82. Il n’a pas pu voir le but de Percudani à Liverpool. Il n’a pas vécu non plus cette journée où on devint champion pendant que le Racing descendait en 2ème division. Malgré tout, sa vie a été remplie de tours de stade, de victoires et de gloire internationale. Il est parti rempli. J’écris cela en pleine agonie. Si il n’y a pas de miracle, dans trois semaines nous jouerons en B, en deuxième division.
Je ne sais pas ce que penserait Rodolfo maintenant, mais je suis sûr que jamais il n’a pu penser que son invincible équipe remplie de Coupes soit là, presque condamnée, à quelques jours d’acquérir cette tâche indélébile. Il m’a fallu énormément d’années pour lui dire au revoir, pour faire un deuil comme il se doit. Je crois que beaucoup de ma tristesse actuelle est due au fait que je ne peux pas arrêter de penser à lui. De penser à toi. Reviens mon vieux. Reviens vêtu en costard enroulé d’un drapeau rouge. Dis-moi que tout ceci n’est qu’une aspirine que m’a envoyé M.Racing. Que nous on mange des bonbons parce que les “amers” c’est eux. Apprends-moi à applaudir un sombrero de Bochini. Prends-moi par la main pour crier sur un but de Bertoni. Si tu ne peux pas revenir, je te comprendrais. Il est temps de me prendre en main seul. Je serais digne. Même si, à l’abri des regards de Lola, je vais pleurer. Salut mon vieux, repose toi dans le ciel inexistant des athées. Un jour, on reviendra. Ceci est aussi un moyen, tardif, de te dire au revoir.
Luciano Olivera